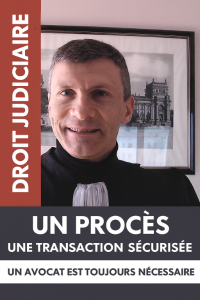Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Décret RIVAGE : réduire les appels, à quel prix pour les justiciables et les juges ?
Le projet de décret dit « RIVAGE » s’inscrit dans une série de réformes de la procédure civile destinées à « simplifier » et à désengorger les tribunaux. L’idée affichée est simple : limiter la possibilité de faire appel pour réduire le nombre de dossiers devant les cours d’appel.
Sur le papier, cela semble logique :
moins d’affaires en appel = plus de temps pour chaque dossier.
Mais derrière cette approche comptable, se jouent des enjeux beaucoup plus profonds :
votre droit à un véritable recours ;
la qualité de la justice rendue ;
et même la manière dont on regarde la personne du juge.
Dans cet article, je vous propose :
d’expliquer ce que cherche à faire RIVAGE,
de montrer pourquoi limiter les appels est une fausse bonne idée,
de présenter des solutions alternatives qui passent par un rôle accru des avocats,
et de poser une question de fond :
et si la vraie réforme passait par la formation commune des juges et des avocats, plutôt que par la fermeture des voies de recours ?
1. Que cherche à faire le décret RIVAGE ?
Sans entrer dans tous les détails techniques, l’esprit de RIVAGE peut se résumer en quelques points clés.
1.1. Les principaux leviers envisagés
Le projet de décret RIVAGE repose notamment sur :
L’augmentation du seuil du dernier ressort
En dessous d’un certain montant (qui pourrait être porté à 10 000 €), la décision serait rendue sans possibilité d’appel.
Autrement dit : pour ces litiges, la décision de première instance devient définitive.
La suppression ou la restriction de l’appel dans certaines matières
Par exemple, pour certains contentieux du quotidien (famille, baux, petits litiges de consommation), il ne serait plus possible d’interjeter appel, ou seulement dans des cas très encadrés.
Le filtrage des appels « manifestement irrecevables »
La cour d’appel pourrait écarter rapidement un appel jugé infondé, parfois sur simple ordonnance, avec un débat contradictoire réduit au minimum.
La généralisation de l’obligation de tentative amiable préalable
Avant de saisir le juge, les parties seraient de plus en plus souvent tenues de passer par une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
L’objectif affiché est clair : faire baisser le flux de dossiers qui parviennent aux cours d’appel.
1.2. Pourquoi le CNB et l’USM s’inquiètent
Le Conseil national des barreaux (CNB) et l’Union syndicale des magistrats (USM) ont exprimé de fortes réserves :
ils y voient une restriction du droit d’appel, surtout pour les « litiges du quotidien » (voisinage, consommation, logement, famille) qui concernent des justiciables souvent fragiles ;
ils dénoncent une réforme qui ne s’attaque pas aux causes profondes de l’engorgement, mais se contente de fermer des portes ;
ils alertent sur la création d’un nouveau contentieux purement procédural (sur les seuils, la recevabilité, les filtres d’appel), qui risque en réalité de complexifier la justice.
En résumé :
RIVAGE prétend simplifier, mais risque surtout de déplacer les difficultés sans les résoudre.
2. Limiter l’appel : une fausse bonne idée pour les justiciables
2.1. Le double degré de juridiction : votre filet de sécurité
Le droit d’appel n’est pas un confort, c’est une garantie fondamentale :
une décision de première instance peut être revue si le droit a été mal appliqué ou si les faits ont été mal appréciés ;
une nouvelle formation de juges, souvent collégiale, peut corriger une erreur, adapter le montant d’une indemnisation, revoir une pension ou un partage.
Concrètement, de nombreux appels aboutissent à :
une augmentation ou une diminution des sommes allouées,
une réévaluation des préjudices (en matière d’accident, de construction, de logement…),
parfois un changement total de solution.
Restreindre l’appel, c’est augmenter le risque qu’une erreur ne soit jamais corrigée.
2.2. Un « petit litige » peut être énorme pour vous
Lorsque l’on parle de seuil à 5 000 €, 8 000 € ou 10 000 €, cela peut paraître « raisonnable » vu de l’administration. Mais pour un ménage :
8 000 € de travaux mal faits,
6 000 € de provision sur un préjudice corporel,
5 000 € de loyers ou de charges contestées,
ce sont des sommes considérables, parfois l’économie de plusieurs années.
Limiter l’appel en fonction d’un montant, c’est finalement dire :
« En dessous de telle somme, vous n’avez pas droit à une seconde chance. »
3. Quand la fermeture de l’appel met aussi les juges en danger
On parle beaucoup des droits des justiciables, et c’est normal. Mais il y a un autre enjeu : la protection de la fonction de juger.
3.1. L’appel comme « tampon institutionnel »
Aujourd’hui, si vous êtes en désaccord avec un jugement, vous pouvez dire :
« Je ne suis pas d’accord, je vais faire appel. »
La critique s’adresse alors à l’institution judiciaire : tribunal, cour d’appel, « la justice » au sens large.
Si l’appel disparaît pour une partie importante des litiges, le rapport change :
le juge de première instance devient le seul et dernier décideur ;
la frustration, la colère ou le sentiment d’injustice se focalisent sur la personne du magistrat :
« C’est tel juge qui m’a détruit »,
« C’est telle juge qui a ruiné ma famille ».
Avec un risque très concret :
davantage de pressions individuelles (lettres, mails, réseaux sociaux),
des menaces, parfois des passages à l’acte,
une atteinte directe à la sécurité et à la sérénité des juges.
3.2. Une justice plus fragmentée, plus inégale
Sans contrôle régulier des cours d’appel :
des litiges comparables peuvent être jugés de manière très différente selon les tribunaux ;
l’unité du droit se délite,
les justiciables ont le sentiment d’une « loterie » judiciaire.
Et là encore, c’est le juge local qui devient la cible, puisqu’il est le seul visage visible de cette « injustice » ressentie.
Limiter l’appel ne protège donc ni les justiciables, ni les magistrats.
Au contraire, cela fragilise les deux.
4. Quelles vraies solutions pour désengorger les tribunaux ?
Réduire les délais et le nombre d’affaires ne passe pas forcément par la suppression des recours. D’autres pistes existent.
4.1. Mieux préparer les dossiers en amont : le rôle clé de l’avocat
Une part importante des lenteurs judiciaires vient de dossiers :
mal structurés,
mal chiffrés,
incomplets sur le plan des pièces.
Un travail approfondi en amont avec un avocat permet :
d’identifier les vraies questions juridiques,
de rassembler et d’organiser les preuves,
de chiffrer correctement les demandes (par exemple, en matière de dommage corporel, selon la nomenclature Dintilhac et la pratique des tribunaux).
Résultat :
des décisions plus solides, mieux motivées, plus compréhensibles,
un moins grand besoin d’interjeter appel, parce que le dossier a été correctement instruit dès le départ.
4.2. « Extérioriser » certains contentieux au profit des avocats
Plutôt que de fermer l’accès à la cour d’appel, on peut sortir une partie des litiges du circuit judiciaire classique, sous le contrôle d’avocats, avec un recours limité au juge.
4.2.1. Quels types de contentieux ?
On peut imaginer de confier en priorité aux avocats :
des litiges de consommation (crédits, téléphonie, énergie, services du quotidien) ;
des petits sinistres assurantiels (dégâts des eaux, bris, vol) ;
des désordres de construction limités (rénovations, finitions, travaux simples) ;
des litiges de voisinage simples (nuisances, haies, stationnement) ;
certains ajustements de pensions alimentaires ou de modalités de droit de visite, lorsqu’il n’y a pas de situation de danger ;
des litiges de recouvrement de créances incontestables (factures impayées, loyers, etc.).
4.2.2. Avec quels outils concrets ?
Plusieurs mécanismes pourraient être renforcés ou créés :
de vraies expertises amiables encadrées par des avocats, avec un cahier des charges précis, un contradictoire respecté, et un poids juridique fort devant le juge ;
des actes d’avocat à force exécutoire, qui, après un contrôle formel, permettraient d’exécuter un accord sans repasser par une procédure classique ;
des procédures participatives renforcées, où les parties, assistées de leurs avocats, peuvent désigner un avocat tiers pour trancher les points de désaccord restant, son avis pouvant être homologué rapidement.
Dans ces schémas :
le juge reste présent comme garant ultime,
mais une grande partie du travail est réalisée en amont, par les avocats, dans un cadre sécurisé et contrôlé.
4.3. Investir dans la justice, plutôt que la contourner
Enfin, il faut le dire clairement :
on ne désengorge pas durablement les tribunaux :
en fermant des voies de recours,
ni en ajoutant toujours plus de formalités.
Les vraies solutions sont structurelles :
recruter davantage de magistrats et de greffiers,
moderniser les outils numériques,
mieux organiser les audiences,
responsabiliser les parties par des sanctions ciblées des appels manifestement abusifs, plutôt que par des seuils automatiques.
5. Repenser la formation : vers une école commune pour juges et avocats
Une autre clé, plus profonde, concerne la formation même de ceux qui rendent et pratiquent la justice.
5.1. Aujourd’hui : deux mondes qui se croisent sans vraiment se connaître
Actuellement :
les magistrats sont recrutés très tôt par un concours spécifique et formés à l’ENM ;
les avocats suivent un autre cursus, un autre concours, une autre école.
Résultat :
des cultures professionnelles qui divergent,
une méconnaissance réciproque des contraintes de l’autre,
parfois une sensation de distance entre la justice rendue et la réalité vécue par les justiciables.
5.2. Demain : un Institut commun des professions judiciaires ?
On peut imaginer une réforme d’ampleur :
la fusion de l’ENM et des écoles d’avocats en un Institut national des professions judiciaires ;
un tronc commun de formation (procédure, déontologie, droits fondamentaux, rédaction des décisions et des actes, gestion d’audience et du justiciable) ;
puis des filières : magistrature, barreau, autres métiers du droit ;
avec de vraies passerelles, permettant à des avocats expérimentés de devenir magistrats, et à des magistrats de rejoindre le barreau.
Pour vous, justiciables, cela signifie :
des juges qui connaissent concrètement la pratique du dossier,
des avocats qui partagent la même culture des droits fondamentaux et du contradictoire,
et, au bout du compte, des décisions plus lisibles, mieux motivées, moins sujettes à contestation.
Une justice de meilleure qualité, c’est aussi moins de recours nécessaires.
6. Concrètement, que pouvez-vous faire en tant que justiciable ?
Face à ces évolutions, quelques réflexes peuvent vous protéger :
Consultez un avocat en amont, avant d’engager une procédure ou de signer une transaction (avec un assureur, un constructeur, un bailleur, un employeur…).
Ne renoncez pas à un recours sans information claire : en matière d’appel, les délais sont stricts et certaines décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Un avis juridique est indispensable pour ne pas laisser passer une chance de contester.
Privilégiez les démarches amiables encadrées, plutôt que les arrangements improvisés, surtout en cas :
d’accident de la circulation ou d’erreur médicale,
de désordres de construction,
de séparation ou de divorce avec enfants.
Besoin d’un avis ou d’un accompagnement dans votre dossier ?
En tant qu’avocat à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), j’accompagne des justiciables :
victimes d’accidents de la circulation ou de fautes médicales,
confrontés à des désordres de construction,
ou engagés dans un divorce ou un conflit familial.
Si vous vous interrogez :
sur l’intérêt de faire appel ou non,
sur la possibilité de régler votre affaire autrement (expertise amiable, négociation encadrée),
ou sur la justesse d’une proposition d’indemnisation,
je peux vous aider à faire le point sereinement et à choisir la stratégie la plus adaptée.
Contactez le cabinet pour un premier échange sur votre situation et vos options.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit judiciaire
- décembre 2025
- novembre 2025