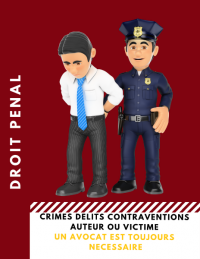Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Contrôle au faciès : la CEDH condamne la France pour discrimination raciale
1. Résumé succinct
Contexte
Dans l’arrêt Seydi et autres c. France (CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17), la Cour européenne des droits de l’homme a examiné les griefs de six ressortissants français d’origine subsaharienne ou nord-africaine, qui estimaient avoir été victimes de contrôles d’identité discriminatoires fondés sur leur apparence.
Impact principal
La Cour a condamné la France pour violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention concernant l’un des requérants, soulignant l’inefficacité des garanties offertes contre les contrôles au faciès. Cette décision s’inscrit dans une série de condamnations européennes renforçant l’exigence de traçabilité et de contrôle des pratiques policières.
2. Analyse détaillée
Les faits
Les six requérants avaient été soumis, entre 2011 et 2015, à plusieurs contrôles d’identité, souvent dans des lieux publics (gares, rues, aéroports). Ils affirmaient n’avoir commis aucune infraction ni comportement suspect. Plusieurs dénonçaient des propos déplacés, des palpations injustifiées, voire des menaces verbales. Aucun procès-verbal ni récépissé ne venait attester de ces interventions policières.
La procédure
Ils ont assigné l’État français devant le TGI de Paris, invoquant une faute lourde du service public de la justice (art. L. 141-1 COJ). Déboutés en première instance, puis en appel, leurs pourvois ont été rejetés par six arrêts de la Cour de cassation du 9 novembre 2016. Le 9 mai 2017, ils ont saisi la Cour de Strasbourg, dénonçant une discrimination raciale prohibée par l’article 14, combinée à une atteinte à la vie privée (article 8).
La Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Défenseur des droits sont intervenus en qualité de tiers.
La décision de la CEDH
Arguments des parties
Les requérants invoquaient un contrôle d’identité fondé uniquement sur leur apparence.
Le gouvernement français arguait que les juridictions internes avaient correctement vérifié la régularité des contrôles.
Raisonnement de la Cour
La Cour rappelle :
Que la discrimination raciale constitue une forme particulièrement odieuse de discrimination.
Que les contrôles d’identité fondés exclusivement sur l’apparence ethnique violent l’article 14.
Qu’il incombe aux autorités de garantir des mécanismes effectifs de recours.
Or :
Aucun procès-verbal n’a été établi.
Les juridictions françaises ont rejeté les demandes sans exiger de justification sur les motifs réels du contrôle.
La Cour établit une violation de l’article 14 combiné à l’article 8 pour l’un des six requérants, en raison d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (profil ethnique, propos du policier, absence de justification plausible).
Solution retenue
La France est condamnée à verser 5 000 € au requérant concerné. Les autres requêtes sont rejetées.
3. Références et articles juridiques
Décision
CEDH, 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, n° 35844/17
Textes cités
Article 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Article 14 CEDH – Interdiction de discrimination :
« La jouissance des droits et libertés [...] doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur [...] la race, la couleur, l’origine nationale ou sociale [...]. »
Article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. »
Article 78-2 CPP (version applicable)
Encadre les contrôles d’identité dans trois hypothèses : suspicion d’infraction, réquisitions du procureur, prévention d’atteinte à l’ordre public.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour confirme que l’absence de traçabilité et de justification individuelle des contrôles rend illusoire tout recours effectif. Elle refuse d’admettre que l’absence de mention écrite ou de récépissé puisse permettre un réel contrôle juridictionnel. Le cadre juridique français n’est pas jugé en lui-même contraire à la Convention, mais son application concrète révèle des lacunes graves.
La jurisprudence antérieure (Muhammad c. Espagne, Wa Baile c. Suisse, Basu c. Allemagne) est mobilisée pour rappeler que :
Une présomption de discrimination peut être tirée d’un faisceau d’indices ;
La charge de la preuve s’inverse dès lors qu’un commencement de preuve est fourni ;
Les États doivent mettre en place des mécanismes permettant de retracer les interventions policières.
5. Critique de la décision
Décisions connexes analysées :
CEDH, 13 oct. 2016, Basu c. Allemagne, n° 215/19
CEDH, 18 févr. 2021, Wa Baile c. Suisse, n° 43998/16
CEDH, 13 févr. 2020, Muhammad c. Espagne, n° 59172/12
Toutes confirment la nécessité d’un encadrement strict, avec procès-verbal ou récépissé et obligation de justification, à défaut de quoi la discrimination raciale est présumée établie.
Le défaut de mécanisme de traçabilité en droit français fait obstacle à la garantie du droit au recours effectif et à la protection contre la discrimination raciale.
6. Accompagnement juridique
Face aux risques de discrimination raciale dans les pratiques de contrôle, il est crucial d’être conseillé par un cabinet expérimenté.
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire, vous accompagne dans :
La constitution de dossiers pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Les actions en responsabilité contre l’État.
La saisine de la CEDH.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal
- octobre 2025
- CJUE, 2 oct. 2025 (C-391/24) : traitement résidentiel fermé = 2008/909, pas 2008/947
- Garde à vue du majeur protégé : pas d’avocat obligatoire (QPC 2025-1169)
- Cantine pénitentiaire : le CE valide la tarification différenciée (3 oct. 2025)
- Solidarité financière URSSAF : la lettre d’observations signée par l’inspecteur suffit
- Ordonnance de renvoi et appel 186-3 CPP : Crim., 6 août 2025, rejet