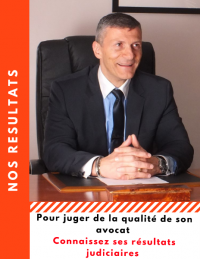Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Harcèlement moral au travail : pas de reconnaissance sans preuves précises
Dans un litige opposant une employée à son ancien employeur, le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître le harcèlement moral, soulignant l’insuffisance des preuves apportées. Une affaire emblématique de la rigueur judiciaire en matière de harcèlement au travail.
Harcèlement moral au travail : une décision exemplaire de rigueur probatoire
Dans un jugement du 5 mai 2025, le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a débouté une salariée de toutes ses demandes fondées sur le harcèlement moral, malgré des accusations graves : propos sexistes, retrait de responsabilités, déstabilisation professionnelle, et refus de congés pour soins médicaux.
La salariée, employée dans un commerce de proximité affilié au réseau Carrefour City, dénonçait une dégradation rapide de ses conditions de travail après un changement de gérance. Elle pointait en particulier l’attitude de son supérieur hiérarchique, arrivé début novembre 2023, qui selon elle l’aurait volontairement privée de ses fonctions décisionnelles habituelles et aurait tenu des propos déplacés.
Elle avait saisi les prud’hommes en avril 2024, après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée.
Une preuve stricte exigée : le harcèlement moral suppose des faits répétés, précis et étayés.
Le Conseil rappelle que selon l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, portant atteinte aux droits, à la santé ou à l’avenir professionnel du salarié.
Or, dans cette affaire :
Le seul propos explicitement reconnu comme sexiste et vulgaire a été qualifié par le Conseil de propos isolé et immédiatement suivi d’excuses écrites de l’auteur.
Les autres griefs (modification d’horaires, refus d’indisponibilités médicales, retrait de fonctions) n’étaient pas corroborés par des éléments objectifs ou des témoignages internes.
Les certificats médicaux présentés faisaient état d’un mal-être psychologique, mais sans lien médicalement établi avec les conditions de travail récentes, d’autant plus que la salariée était suivie pour des troubles similaires depuis 2020.
Les témoignages provenaient exclusivement de proches ou de tiers n’ayant jamais travaillé sur place, et ne pouvaient attester des faits dans l’entreprise.
Une décision rigoureuse mais pédagogique sur le plan juridique
Dans sa motivation, le Conseil souligne que le seul fait d’avoir mal vécu une réorganisation ou des exigences nouvelles de la hiérarchie ne suffit pas à caractériser un harcèlement. Il rappelle que les tensions liées à l’exercice normal du pouvoir de direction, même vécues comme injustes ou malvenues, ne sont pas en elles-mêmes constitutives d’un harcèlement moral.
De plus, la relation de travail avec le nouveau gérant n’a duré que quelques jours avant l’arrêt maladie de la salariée, ce qui rendait difficile l’établissement d’un schéma de pression ou de comportement répété sur une durée significative.
Ainsi, le Conseil déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement, ainsi que de ses autres demandes liées à la rupture du contrat, et la condamne aux dépens.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision met en lumière un point essentiel pour tout salarié se sentant victime de harcèlement :
Un seul fait, aussi choquant soit-il, ne suffit pas.
Il faut des faits répétés, documentés (mails, attestations internes, certificats médicaux explicites).
Les témoignages extérieurs ou familiaux sont généralement considérés comme insuffisants.
Le lien entre les faits dénoncés et les troubles de santé doit être clairement établi par des professionnels de santé.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail - Décisions obtenues par le cabinet
- juillet 2025
- juin 2025
- Représentation équilibrée femmes-hommes aux élections CSE : la Cour de cassation précise l’alternance
- Travail temporaire et responsabilité pénale : la Cour de cassation rappelle les limites des poursuites
- CSP et plan de départs volontaires : la Cour de cassation trace la limite
- Vidéosurveillance et licenciement : Validation de l’utilisation de preuves sous RGPD